Ce devait être des retrouvailles. En effet, bien qu’ayant adoré ses premiers romans, je suis resté longtemps sans lire David Vann. La joie était donc là, et l’impatience de retrouver son univers, la poésie de sa plume, bien réelle.
Car David Vann n’est pas un auteur anodin. On ouvre toujours l’un de ses romans avec l’attente d’un choc, d’une tension morale ou d’un vertige intime.
Avec « La jeune fille et la mer », le décor change, mais les promesses demeurent.
Une île pauvre des Philippines, la mer comme horizon et comme piège, une jeune femme prête à risquer son corps pour s’arracher à la misère, et un homme occidental vieillissant, porteur d’illusions autant que de domination.
Tout est en place, et pourtant le roman laisse au final, une impression persistante de rendez-vous manqué.
Aica a vingt et un ans. Elle vit sur une île sans avenir, dans une famille qui survit à peine. Son désir de départ n’a rien de romantique. Il est économique, vital. Elle sait ce qu’on attend d’elle, ce que les étrangers viennent chercher, et ce que son corps peut lui permettre d’acheter pour les siens.
Lorsque Bob apparaît, Américain quinquagénaire vivant sur son voilier, l’échange implicite est clair d’emblée. Elle montera à bord, il lui promettra une autre vie. Le roman ne joue pas sur l’ambiguïté, et c’est sans doute là l’une de ses premières limites.
Le huis clos maritime, qui devrait installer une tension progressive, tourne rapidement à vide. La relation entre Aica et Bob se réduit à une succession de scènes sexuelles pesantes, répétitives, rarement signifiantes sur le plan narratif. Loin d’éclairer les rapports de domination ou les mécanismes d’aliénation, elles finissent par produire l’effet inverse.
Elles appauvrissent le propos et enferment les personnages dans une caricature dont ils ne parviennent jamais à s’extraire. Bob n’évolue pas. Aica non plus, ou si peu. La promiscuité du bateau, au lieu d’aiguiser la psychologie, l’émousse.
Le drame survient, attendu, prévisible. Il déclenche un basculement du récit, mais sans véritable surprise ni nécessité intérieure. La trajectoire d’Aica, censée interroger l’émancipation, la survie, la liberté chèrement acquise, s’enlise dans une suite de décisions forcées, souvent peu crédibles, parfois franchement invraisemblables.
L’apprentissage de la navigation, la gestion du bateau, tout ce qui est évacué trop vite dans le récit donne le sentiment d’une mécanique narrative peu soucieuse de réalisme, comme si le roman avançait par commodité plutôt que par exigence.
Plus problématique encore, le regard porté sur les Philippines et leurs habitants paraît figé, presque daté, caricatural. La misère est omniprésente, mais sans nuances. Les personnages secondaires sont à peine esquissés, réduits à des fonctions symboliques. Les étrangers sont tous prédateurs ou lâches, les locaux enfermés dans une passivité sans issue.
Rien ne vient troubler cette vision binaire, ni la complexifier. La critique sociale, pourtant centrale dans le projet, reste lourde, démonstrative, et finit par étouffer toute possibilité d’émotion sincère.
 Sur le plan stylistique, la déception est réelle. Là où l’on attendait une écriture tendue, âpre, parfois poétique, on trouve des dialogues plats, des redites, une langue crue qui ne sert pas toujours le propos. La mer, habituellement chez Vann un espace mental autant que physique, devient ici un simple décor, incapable de porter une véritable métaphore existentielle.
Sur le plan stylistique, la déception est réelle. Là où l’on attendait une écriture tendue, âpre, parfois poétique, on trouve des dialogues plats, des redites, une langue crue qui ne sert pas toujours le propos. La mer, habituellement chez Vann un espace mental autant que physique, devient ici un simple décor, incapable de porter une véritable métaphore existentielle.
Le texte avance sans souffle, comme un voilier sans cap, dérivant d’une scène à l’autre sans jamais provoquer le trouble espéré. Reste une impression d’indifférence, peut-être la plus cruelle pour un lecteur fidèle. « La jeune fille et la mer » ne scandalise pas, ne bouleverse pas, ne dérange pas durablement. Il expose une situation sordide sans parvenir à lui donner une véritable épaisseur romanesque.
On achève le livre avec le sentiment d’un potentiel gâché et d’une noirceur plaquée plutôt que creusée, sans jamais atteindre la densité que l’on est en droit d’attendre de David Vann.
On continue d’estimer l’auteur, bien sûr. On se souvient de ce qu’il a su faire dans ses œuvres précédentes, autrement, avec une puissance bien supérieure. Mais ce roman-là ressemble davantage à un échouage qu’à une traversée. Une parenthèse décevante, que l’on espère isolée.
ACQUISITION: LIBRAIRIE

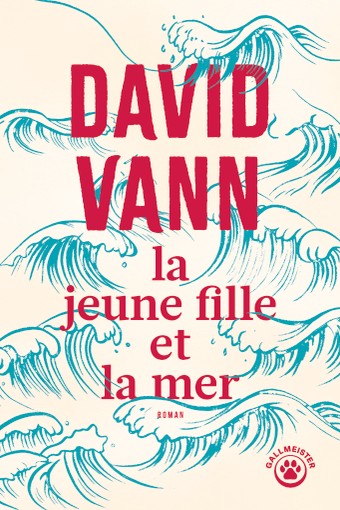
0 commentaires