ACQUISITION: LIBRAIRIE
Nous avions découvert Pierre Chavagné à l’occasion de la sortie de son premier roman, « la femme paradis » . C’était une très belle découverte et une belle réussite.
Autant dire que son nouveau roman était attendu avec impatience et curiosité.
Comme pour son premier ouvrage, la nature et la survie à l’écart d’un monde en décrépitude sont au cœur du récit.
Abena ce n’est pas un cri , c’est un souffle. Un souffle glacé, rude, venu des hauteurs, qui vous serre la gorge autant qu’il vous éclaire.
En plaçant son récit au cœur d’un massif enneigé, Pierre Chavagné choisit un théâtre à la fois majestueux et impitoyable, un décor minéral pour sonder ce qu’il reste de chaleur dans l’âme humaine.
Kofi et sa sœur Abena fuient. On ne sait pas tout de leur passé, mais on comprend très vite que le présent les accable. Pourchassés par une milice appelée « la Souche », ils incarnent ces silhouettes anonymes que l’on voit parfois apparaître dans les marges de l’actualité. Des êtres qui marchent, espèrent, fuient, sans certitude d’un avenir.
Leur errance prend un tour inattendu lorsqu’ils croisent Caïn, un homme marginal, sauvage, qui les mène jusqu’à un abri de fortune dans la montagne.

@neha-maheen-mahfin
Là vivent Jo, surnommée la Vieille, et Rob, dit l’Aveugle. Deux ermites reclus, maîtres d’un refuge en équilibre précaire.
Dès lors, le roman glisse dans un huis clos tendu, suspendu dans un isolement où la cohabitation devient une nécessité aussi vitale que périlleuse.
Pierre Chavagné compose autour de cette situation extrême une galerie de personnages des plus marquants.
Abena, la plus jeune, est le cœur battant du récit. Observatrice silencieuse, elle incarne à la fois l’innocence et la survie, la fragilité et la lumière.
Kofi, son frère, porte le poids du réel, celui de la fuite, de la peur et du devoir.
Caïn, quant à lui, est une figure ambivalente et mystérieuse. A la fois guide, protecteur, et mémoire en errance, il lit, enseigne, écoute plus qu’il ne parle.
Le couple d’ermites, Jo et Rob, agit comme un socle ancien. La première règne sur l’organisation quotidienne avec une autorité bienveillante, quand le second, muré dans le silence, offre une forme de sagesse paisible, presque intérieure.
Enfin, Paul, milicien de la Souche, incarne la menace la plus brutale. Empreint d’une haine idéologique et d’un fanatisme froid, il rôde autour du refuge comme une figure de cauchemar, réduisant l’altérité à une cible.
Ensemble, ces personnages forment un microcosme riche, vibrant, où chaque parole, chaque silence, devient porteur de tension ou de grâce.
Dans cette nature indomptée, chaque geste compte, chaque silence pèse. Il y a dans ce roman une écoute rare , celle des failles, des douleurs, mais aussi de la beauté.

@francesco-ungaro
Beaucoup se joue dans les regards, dans les non-dits, dans la manière dont chacun tente de préserver un fragment d’humanité dans un monde disloqué.
L’écriture de l’auteur évite l’emphase tout en étant d’une grande puissance évocatrice.
Les descriptions de la montagne sont saisissantes et racontent quelque chose. Elles deviennent une langue à part entière, que doivent apprendre ces hommes et ces femmes coupés du reste du monde.
Pierre Chavagné sait que les mots justes sont plus puissants que les effets, et son style le prouve à chaque page. Il écrit comme on pose un pas sur la neige, avec attention et gravité.
On pourrait dire que le roman parle d’exil, de frontières, de xénophobie, mais ce serait trop simple. Abena parle surtout d’humanité. De ce que devient l’homme quand il est confronté à la peur, au froid, à la faim, au silence.
Il questionne sans asséner, montre sans expliquer. Et ce qu’il donne à voir, c’est que, même dans l’ombre, il reste des gestes qui sauvent, des regards qui relient, des fragments d’entraide qui tiennent le chaos à distance.
Abena est d’abord un roman sur la condition humaine, sur ce que devient l’homme quand le monde autour de lui vacille. Il y a dans le personnage éponyme quelque chose d’universel , cette capacité à endurer, à observer, à incarner une forme d’avenir, même incertain.
À travers elle, Pierre Chavagné rappelle que l’espoir, parfois, tient dans la main d’un enfant.

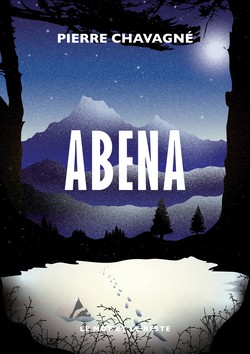
Beaucoup d’ingrédients qui me tentent : le huis clos, la nature indomptée… je note !
bonjour Violette ! ce roman va te plaire j’en suis sur. Moi c’est un auteur que j’aime beaucoup que j’avais découvert l’année dernière avec un court roman, ” La femme paradis” et que j’avais adoré ! si tu le lis , tu me diras ce que tu en auras pensé ! 🙂